Changer de comportements grâce à la pensée de l’obstacle
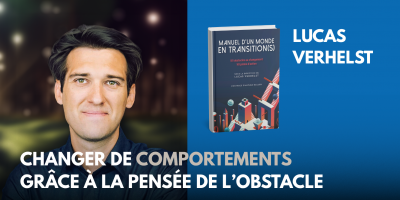
Ah la transition, ce changement que certains appellent de leurs vœux. Ces souhaits qui flottent sans amerrir. Ces discours qui la réclament sans la décrire. C’est sûr, depuis plusieurs années, la transition est sur nos lèvres. Mais est-elle dans nos vies? Comment faire mieux que Paul Éluard pour qui, dans le poème “Liberté”, nommer suffit? Comment aller au-delà de “Transition, j’écris ton nom”?
Analyse du livre Manuel d’un monde en Transition(s) suite à l'interview du dir. de l'ouvrage, Lucas Verhelst, par Cécile Gruet
Pour ce faire, les approches habituelles n’ont plus leur place. À piloter au rétroviseur, nous restons dans le même sillage. En conservant la même manière de voir les choses, nous ne voyons pas le kaléidoscope de la complexité de la situation. Et si nous posons mal le problème, comment espérer le résoudre? Exit donc les “Yakafokon”, les phrases toutes faites et l’explication d’un problème complexe par un facteur simple.
Non, ce qu’il faut, en tout cas ce que prônent le directeur de l’ouvrage “Manuel d’un monde en transition(s)” et ses co-auteurs et co-autrices, c’est adopter une nouvelle approche. Pour ce faire, retour… aux origines! Et quelle est l’origine de l’absence d’un mouvement, sinon l’obstacle? Nous avons des cailloux dans nos chaussures mais, à l’inverse du Petit Poucet qui s’en déleste pour s’orienter, nous nous enfonçons dans la forêt. Les poches pleines mais les perspectives, plates.
Oui, les obstacles sont sexy
La démarche de cet ouvrage dirigé par Lucas Verhelst est simple. Analyser les obstacles, ce qui entrave l’action, afin de permettre le mouvement voire réorienter la trajectoire. D’où le nom de ce nouveau courant de pensée : l’impédimentologie (du latin impedi, qui signifie « dans les pieds » et par extension, ce qui est un obstacle, une gêne, un empêchement).
À première vue, les obstacles ne soulèvent pas les foules. Lucas Verhelst, architecte-urbaniste de formation impliqué depuis des années dans les transitions sociétales l’explique, “Peu de gens s’intéressent aux obstacles, on a beaucoup de prescripteurs de solutions, mais visent-ils vraiment des changements de comportements?”.
D’une part, on a donc des solutions qui rassurent et des théoriciens et intellectuels qui ne s’intéressent pas toujours à l'opérationnalisation de leurs concepts. De l’autre, des obstacles qui sont associés à quelque chose de négatif. Pourtant, ils sont au cœur du problème. Dans toute action visant un changement de comportement, si les obstacles ne sont pas pris en compte, cela favorise l’homéostasie, à savoir le retour du système à son état d’origine. C’est-à-dire… le calme plat. Une mer d’huile. Une panne moteur. Bref, nous continuons comme avant, avec la constance opiniâtre de celles et ceux qui ne veulent pas changer de voie.
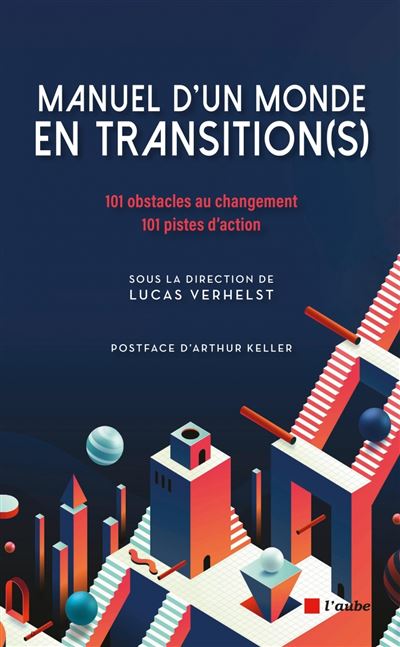
La transition se conjugue au pluriel
Est-ce un pur travail de recherche ? Est-ce un guide pratique? “À la fois l’un et l’autre, répond Lucas Verhelst. C’est un ouvrage de recherche-action”, explique-t-il.
Et si l’on pensait d’entrée de jeu que cet ouvrage visait la seule transition écologique, nous ferions fausse route. Le pluriel au mot “Transition” dans le titre met la puce à l’oreille. Pour les auteurs et autrices, il n’y a pas qu’une seule voie possible vers un autre monde.
Aussi, ce travail de recherche-action tend à donner des clés pour “passer d’un état à un autre”, quel que soit cet état.
Trois clés pour passer d’un état à un autre
Ces clés, quelles sont-elles? Si l’ouvrage ne se réduit pas à une liste de solutions, il propose une méthode de compréhension et d’action.
1. Identifier les attitudes et comportements qui entravent le mouvement. Ils peuvent être de quatre types:
- Les obstacles de nature neuropsychologique recouvrent tout ce qui est biais cognitifs, l’effet spectateur, la réactance…
- Ceux qui sont de nature sociologique forment le plus gros bloc. Ils désignent les dysfonctionnements de nos rapports sociaux.
- Les obstacles de nature politologique sont relatifs à des phénomènes politiques comme la gouvernance, l’électoralisme, etc.
- Enfin, les obstacles épistémologiques désignent toutes les difficultés que l’on a à connaître nos connaissances. Comme les difficultés à saisir les réactions en chaîne ou le “confusionnisme sémantique”, soit le trouble créé par la mauvaise utilisation de certains mots à des fins politiques ou autres.
Pour identifier ces 101 obstacles, les auteurs et autrices ont écouté les voix qui se lèvent. Les murmures de plaintes, les signaux faibles, le bruit sur les réseaux sociaux, le vent de l’actualité qui charrie avec lui, des phrases qui se ressemblent. “C’est la faute de la croissance”, “Il y a trop de normes”, “le problème, ce sont les biais cognitifs”, “non, le vrai problème, c’est le modèle de nos entreprises”, … Et dans cette dissonance, ils et elles ont gardé les sons de cloche récurrents. Du phénomène de réactance qui désigne le sentiment de perte que l’on ressent lorsqu’on nous prive de quelque chose à la dépendance au sentier (nous aimons faire comme avant, quand bien même cela n’est pas le plus pratique), l’éventail est large. Lucas Verhelst sourit, “tout le monde avait un peu sa marotte mais tout le monde fonctionnait de la même manière,... avec le syndrome de la cause unique.”
2. Proposer des expédients permettant de traiter les obstacles en question. Ce sont rien de moins que des antidotes ! C’est-à-dire des comportements venant compenser les effets négatifs des comportements posant problème. Le Manuel d’un monde en transition(s) recense une centaine d’expédients, au minimum un par obstacle au changement.
“En miroir de chaque obstacle, nous proposons une attitude-clé", explique Lucas Verhelst. Comment ont-elles été établies? Non pas grâce à une approche 100% théorique, mais avec du pragmatisme, de l’empirisme, du bon sens et la conviction que l’on a le droit de faire des erreurs.
Par exemple, face au phénomène des bulles informationnelles sur les réseaux sociaux, les auteurs recommandent de promouvoir la "théorie de l'esprit", cette capacité à se représenter les états mentaux de l'autre personne.
3. Enfin, activer un public-cible de prescripteurs: les transitionneurs et transitionneuses. C’est-à-dire toute personne qui s’emploie à agir de manière à respecter les limites planétaires. L’objectif? Atteindre une “masse critique”, c’est-à-dire un nombre suffisamment conséquent d’individus sensibilisés par une cause de manière à ce que le reste de la population s’approprie cette cause et que cela fasse tache d’huile. C’est aussi appelé la "théorie du centième singe".
Bref, ce livre de recherche-action est utile pour comprendre comment créer un changement de comportements. Et se prête aussi à une lecture moins religieuse. Si vous voulez comprendre les liens entre l’éruption d’un volcan et la naissance du vélo, ou les raisons qui nous poussent à conserver l’emplacement des lettres sur nos claviers d’ordinateur malgré son peu de praticité actuelle, c’est bien aussi!
Interview et article: Cécile Gruet
Liens utiles:
La Télé, émission du 14.03.2025: https://latele.ch/emissions/marque-page/marque-page-s-2025-e-50
Site web de l’institut de l’impédimentologie (Genève): https://i3-institut.org/
Acheter le livre en Suisse: https://www.payot.ch/Detail/9782815958479
